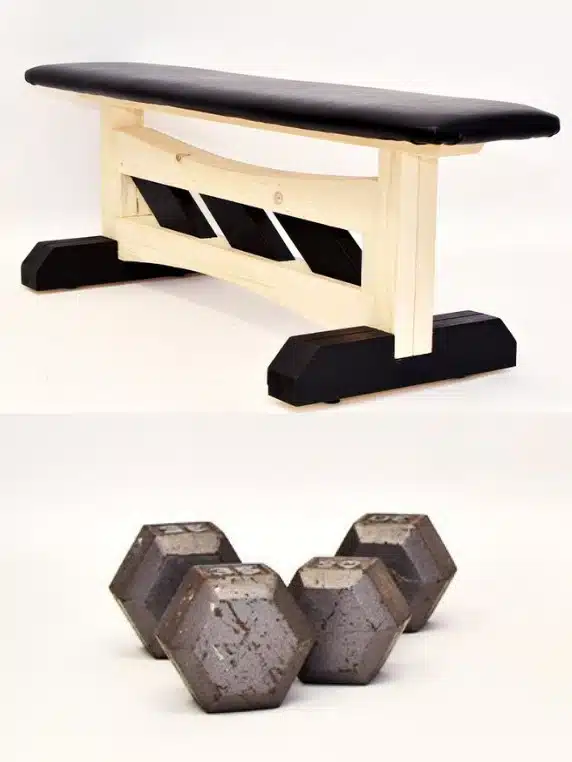Un apport insuffisant en glucides pendant l’entraînement intensif peut provoquer une baisse rapide des performances, voire des troubles de la récupération. Certains sportifs expérimentés misent pourtant sur des régimes pauvres en glucides, espérant améliorer leur endurance, au risque de compromettre leur progression.
Les besoins varient selon le type d’activité, la durée et l’intensité. Les recommandations officielles diffèrent pour un marathonien, un cycliste ou un adepte de sports collectifs. Les choix alimentaires, souvent dictés par des croyances ou des tendances nutritionnelles, ne tiennent pas toujours compte de la physiologie propre à l’effort.
Les glucides, alliés incontournables des sportifs
Pour ceux qui cherchent à progresser, le constat est clair : les glucides tiennent le premier rôle dans l’apport d’énergie au muscle en plein effort. À chaque répétition, à chaque foulée, ce sont les réserves de glycogène, stockées dans les muscles et le foie, qui alimentent la machine. Lorsque ces réserves s’amenuisent, la puissance chute et la fatigue ne tarde pas à s’imposer.
Les différences entre les sports ne remettent pas en question cette règle. Les adeptes de musculation comme les marathoniens en font l’expérience : les fibres musculaires de type II, sollicitées dans les efforts explosifs, puisent dans le glycogène via la glycolyse anaérobie. Ce mécanisme génère l’ATP, l’énergie qui propulse l’action. Dès lors que les réserves se tarissent, les performances s’effritent, la récupération ralentit et le risque de blessure s’accentue.
Pour soutenir la progression, il faut veiller à la répartition des apports : les glucides devraient constituer 40 à 60 % de l’énergie quotidienne. Ce pourcentage favorise le maintien des stocks énergétiques, stabilise la glycémie et optimise la récupération. Après l’effort, reconstituer le glycogène devient prioritaire ; négliger ce point, c’est s’exposer à la stagnation. L’hydratation ne doit pas être négligée non plus, car l’eau accompagne le glycogène pour restaurer le muscle.
| Rôle | Conséquence d’un déficit |
|---|---|
| Source d’énergie pour le muscle | Fatigue précoce, baisse de performance |
| Maintien des réserves de glycogène | Récupération altérée, risque de blessure |
Faut-il vraiment distinguer sucres rapides et lents ? On démêle le vrai du faux
La vieille opposition entre glucides simples et complexes ne suffit plus pour comprendre leurs effets sur la performance. Pendant longtemps, « sucres rapides » (glucose, fructose, saccharose) et « sucres lents » (amidon, maltodextrine, isomaltulose) structuraient les conseils. Mais l’index glycémique (IG) a changé la donne : il mesure la vitesse à laquelle un aliment élève la glycémie, un critère décisif pour choisir ses glucides avant, pendant ou après l’effort.
Les aliments à IG élevé provoquent une montée rapide de la glycémie, suivie d’un pic d’insuline. Idéal pour la récupération immédiate, mais risqué avant un effort long : gare au contrecoup. À l’opposé, les glucides à IG bas, patate douce, flocons d’avoine, quinoa, libèrent leur énergie plus lentement, maintenant une glycémie stable. Ce sont des alliés fiables pour le dernier repas avant la séance ou le petit-déjeuner du sportif.
La notion de charge glycémique apporte une nuance : elle combine l’IG et la quantité consommée. Manger peu d’un aliment à IG élevé n’a pas le même effet que de grosses portions d’un aliment à IG bas.
Voici des repères pour bien utiliser chaque type de glucides :
- Avant l’entraînement : préférez les aliments à IG bas, pour éviter les variations brutales de la glycémie.
- Pendant l’effort : les glucides à IG élevé apportent un soutien immédiat, surtout pour les longues distances ou les séances intenses.
- Après l’effort : un apport rapide favorise la reconstitution du glycogène musculaire.
Ce qui compte, c’est moins la structure du sucre que le moment de la prise, l’index glycémique et la charge globale. Cette approche permet d’affiner sa stratégie nutritionnelle au fil des entraînements.
Quels glucides privilégier avant, pendant et après l’entraînement ?
Le tempo alimentaire fait toute la différence. Avant l’effort, les glucides à IG faible issus de pâtes complètes, riz brun, flocons d’avoine, quinoa ou patate douce offrent une libération lente du glucose. Ce choix permet d’arriver à la séance avec une énergie stable et d’éviter tout coup de mou. Pensez à les intégrer lors du dernier repas : ils remplissent les réserves musculaires sans bouleverser le confort digestif.
Pendant l’entraînement, place à l’efficacité. Pour les efforts prolongés ou très intenses, misez sur des glucides à IG élevé : banane mûre, fruits secs, pain blanc, gels énergétiques. Leur assimilation rapide permet de soutenir l’intensité sans délai. Les boissons d’effort isotoniques (osmolarité de 270 à 320 mOsm/L) combinent glucides et sodium, limitant la déshydratation et maintenant la performance. La conformité de ces boissons avec la norme AFNOR NF EN 17444 assure une utilisation sans risque sur le plan réglementaire.
Après l’entraînement, le muscle réclame du carburant. Ciblez les glucides à IG élevé : pommes de terre vapeur, riz blanc, pain de mie. Ajoutez une hydratation adaptée et un apport en protéines pour accélérer la récupération. Chez les plus jeunes, l’eau reste le meilleur choix en dehors des conditions extrêmes : la simplicité suffit.
Quand demander conseil à un pro pour adapter ses apports ?
La routine rassure, mais tout sportif expérimenté sait que l’ajustement personnalisé fait la différence. Dès que les entraînements gagnent en intensité, que la charge de travail évolue ou que la progression ralentit, mieux vaut consulter. Un diététicien-nutritionniste ajuste la ration glucidique selon la discipline, la durée et l’intensité. Pas de recette universelle : chaque profil impose ses besoins.
Adapter son alimentation à son programme d’entraînement est une nécessité. La stratégie diffère selon qu’on vise une prise de masse, un marathon ou un sport collectif. Même si les textes de référence (ANSES, AFSSA) conseillent 40 à 60 % d’apports glucidiques, la pratique impose des ajustements. Seul un accompagnement personnalisé permet de coller à la réalité du terrain.
Certains signaux doivent alerter : troubles digestifs, fatigue persistante, blessures fréquentes. Un professionnel passera alors en revue la qualité des sources glucidiques, leur répartition dans la journée, et la complémentarité avec protéines et lipides. Il pourra affiner la stratégie, en tenant compte de plusieurs paramètres :
- Adaptation aux besoins spécifiques de la discipline (musculation, endurance, sports collectifs)
- Prise en compte des contraintes personnelles (allergies, végétarisme, emploi du temps)
- Prévention des carences et optimisation de la récupération
Anticiper, ajuster, affiner : c’est là que l’énergie ne flanche pas, que le geste reste précis et que chaque séance devient une nouvelle étape vers la performance.