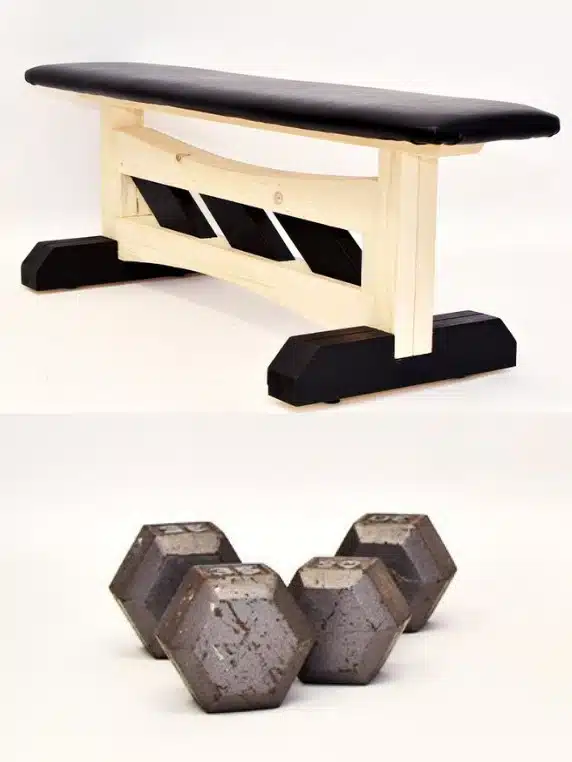Un sport accueilli aux Jeux olympiques peut disparaître dès l’édition suivante, sans que sa popularité ni sa visibilité ne le protègent. La composition du programme olympique obéit à des règles mouvantes, souvent dictées par des intérêts politiques et économiques bien plus que par la seule passion du sport.
Cette instabilité alimente le débat : comment expliquer qu’une discipline applaudie par le public et soutenue par les médias puisse se voir écartée si rapidement ? L’éviction du breaking pour 2028 met en lumière les zones grises de la gouvernance olympique et pose la question du futur pour les sports émergents.
Pourquoi le breaking ne fera pas son retour en 2028 : état des lieux et enjeux
En 2024, le breaking a électrisé Paris et offert au public un spectacle inédit, fusionnant l’esprit battle et la force créative du hip-hop. Mais la fête a tourné court. Pour l’édition de Los Angeles, le Comité d’organisation (LA2028) a fait d’autres choix. Plutôt que de reconduire le breaking, il a privilégié cinq disciplines : baseball/softball, cricket, squash, flag football et crosse. Cette sélection, validée lors d’une session à Bombay, a fermé la porte au breaking pour 2028.
Le choix ne tient ni à une question de tendance, ni à la seule audience. Les organisateurs américains ont fait valoir le poids économique et symbolique de certains sports. Baseball et flag football sont des emblèmes nationaux, moteurs d’audience et de revenus télévisuels. Le cricket vise l’immense marché indien, incontournable pour qui veut toucher des millions de téléspectateurs. Face à cela, le breaking, bien qu’enfant du Bronx et pilier de la culture urbaine, n’a pas pesé suffisamment lourd, malgré le parcours de Dany Dann à Paris et l’engagement de la FFDanse.
En coulisse, la stratégie du CIO questionne. L’ère Thomas Bach devait être celle de l’ouverture aux jeunes et à de nouveaux codes. Finalement, les considérations économiques et la pression des organisateurs locaux ont dicté la marche à suivre.
Les faits à retenir sont clairs :
- Le breaking a bénéficié d’une place à Paris, comme sport additionnel
- Il disparaît du programme de Los Angeles, remplacé par des disciplines jugées plus porteuses ou mieux ancrées localement
Les figures du breaking français, tels Charles Ferreira ou Abdel Mustapha, n’ont pas caché leur déception. La parenthèse olympique refermée, la communauté internationale devra patienter avant de retrouver une scène aussi prestigieuse.
Changement climatique et économie : des facteurs décisifs dans les choix olympiques
Le CIO avance désormais sous le regard insistant des enjeux écologiques. Le changement climatique bouleverse les méthodes habituelles : chaque discipline, chaque site, chaque technologie est ausculté à la loupe pour limiter l’empreinte écologique. À Los Angeles, la gestion des émissions de gaz à effet de serre s’invite dans chaque planification. Impossible, désormais, de retenir un sport sans mesurer son impact environnemental, tant au niveau des infrastructures que du déroulement des compétitions.
Certaines disciplines trouvent leur place dans cette nouvelle donne : le surf ou le skateboard, par exemple, tirent leur épingle du jeu grâce à leur relative sobriété logistique. À l’inverse, le breaking implique des sites couverts, des systèmes de ventilation sophistiqués, une mise en lumière énergivore. Face à la nécessité de limiter la consommation et de s’adapter à la transition écologique, ce détail technique pèse désormais aussi lourd qu’un argument financier.
L’économie olympique, elle aussi, a changé de visage. Les organisateurs doivent anticiper la hausse des coûts induite par le réchauffement, gérer la rareté de l’eau, repenser la mobilité. À Los Angeles, la sélection d’un nouveau sport ne se justifie que s’il s’inscrit dans une logique de développement durable ou d’innovation.
Trois grandes tendances structurent aujourd’hui la réflexion :
- Réduire la mobilité internationale des participants et du public
- Alléger la facture énergétique des sites sportifs
- Mettre en avant les disciplines déjà populaires sur le territoire hôte
Les choix du flag football ou du baseball illustrent ces priorités : des sports qui ne nécessitent pas de nouveaux équipements majeurs, et qui rencontrent déjà un large public local. Le CIO tente d’équilibrer ambitions sportives, contraintes écologiques et réalités financières, dans un contexte où chaque décision est scrutée.
Les marchés boursiers influencent-ils vraiment la programmation des disciplines ?
L’argent irrigue chaque recoin de l’olympisme, mais l’influence du monde financier sur la sélection des sports s’affirme de plus en plus. Le choix de disciplines comme le cricket ou le baseball/softball pour 2028 n’est pas qu’une affaire de tradition. Il s’agit d’un calcul stratégique : attirer les diffuseurs américains, séduire les sponsors, occuper des marchés clés, notamment l’Inde, pays du cricket-roi.
Le cricket s’appuie sur une base de fans colossale en Asie. L’International Cricket Council (ICC) pèse lourd, et le public potentiel dépasse le milliard de personnes. Résultat : des droits télévisuels records, des contrats avec de grandes entreprises, des perspectives de revenus qui font tourner les têtes des décideurs. Selon le CIO, les retombées des droits audiovisuels se chiffreraient en milliards d’euros. Les Américains, eux, font le pari du flag football ou de la crosse, deux sports qui parlent au cœur du public local et rassurent les investisseurs. Le breaking, malgré son aura dans les milieux urbains, reste un poids plume sur l’échiquier financier mondial.
La programmation olympique se pilote aujourd’hui comme un tableau de bord. Trafic aérien, audiences en streaming, rentabilité des infrastructures : tout est passé au crible. Les organisateurs de Los Angeles 2028 et le CIO avancent sous le regard des marchés, avec pour objectif de combiner visibilité, rentabilité et équilibre entre héritage et nouveauté.
Vers un nouvel équilibre pour les Jeux : ce que l’avenir réserve au breaking et aux sports émergents
Le breaking, bien que sorti du programme olympique pour 2028, ne compte pas disparaître des radars. En France, la FFDanse a ouvert la voie : dès 2022, un pôle d’excellence a vu le jour à l’INSEP, réunissant huit talents autour d’un projet inédit. Un diplôme d’entraîneur breaking, lancé en 2023, vient structurer la discipline, la faisant passer du cercle underground aux standards du haut niveau, tout en respectant sa créativité.
L’horizon s’étend au-delà de Paris. La Fédération mondiale de danse sportive (WDSF) poursuit ses efforts auprès du CIO : Brisbane 2032 pourrait bien offrir une nouvelle chance au breaking. Déjà présent aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en 2018 puis programmé aux Jeux mondiaux à Chengdu en 2025, le breaking poursuit son ascension. Les battles, ces affrontements où b-boys et b-girls rivalisent de technique et d’inventivité, captivent une génération avide de nouveauté et de sincérité.
Sous la houlette de Thomas Bach, le CIO cherche encore la formule idéale pour conjuguer héritage et modernité. Le breaking, avec son ADN hip-hop, ses racines urbaines et la vitalité de sa communauté, conserve toutes ses chances de revenir sur le devant de la scène. D’autres disciplines, telles le skateboard ou le flag football, incarnent aussi ce tournant du mouvement olympique où chaque sport doit, à sa façon, prouver qu’il est capable de réinventer la fête sous les anneaux.
Face au va-et-vient des disciplines olympiques, une certitude demeure : le breaking a déjà posé sa marque, et la jeunesse mondiale n’a pas fini d’inventer de nouveaux pas sur la scène internationale.